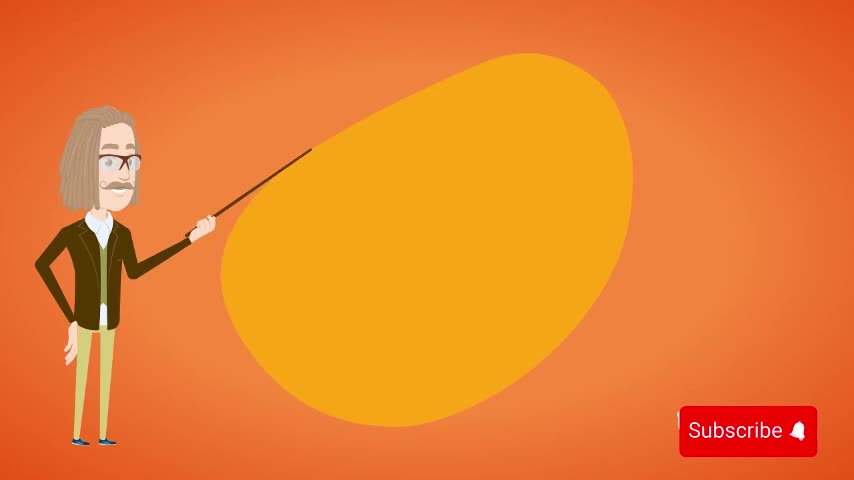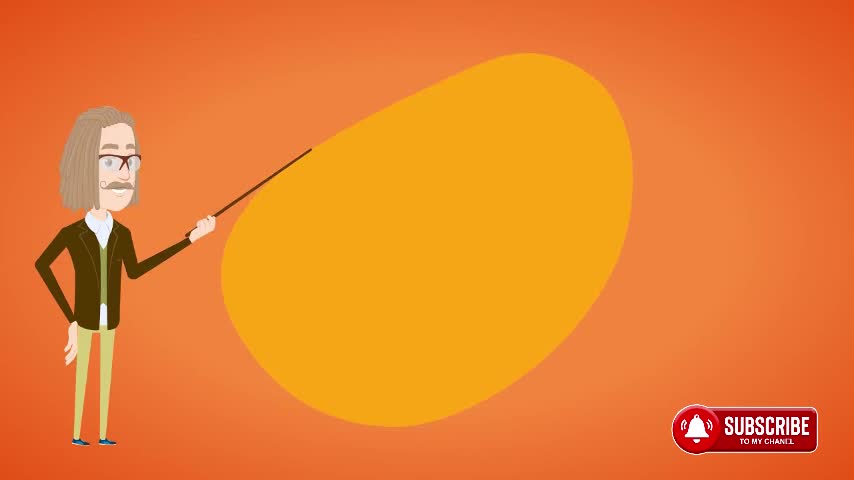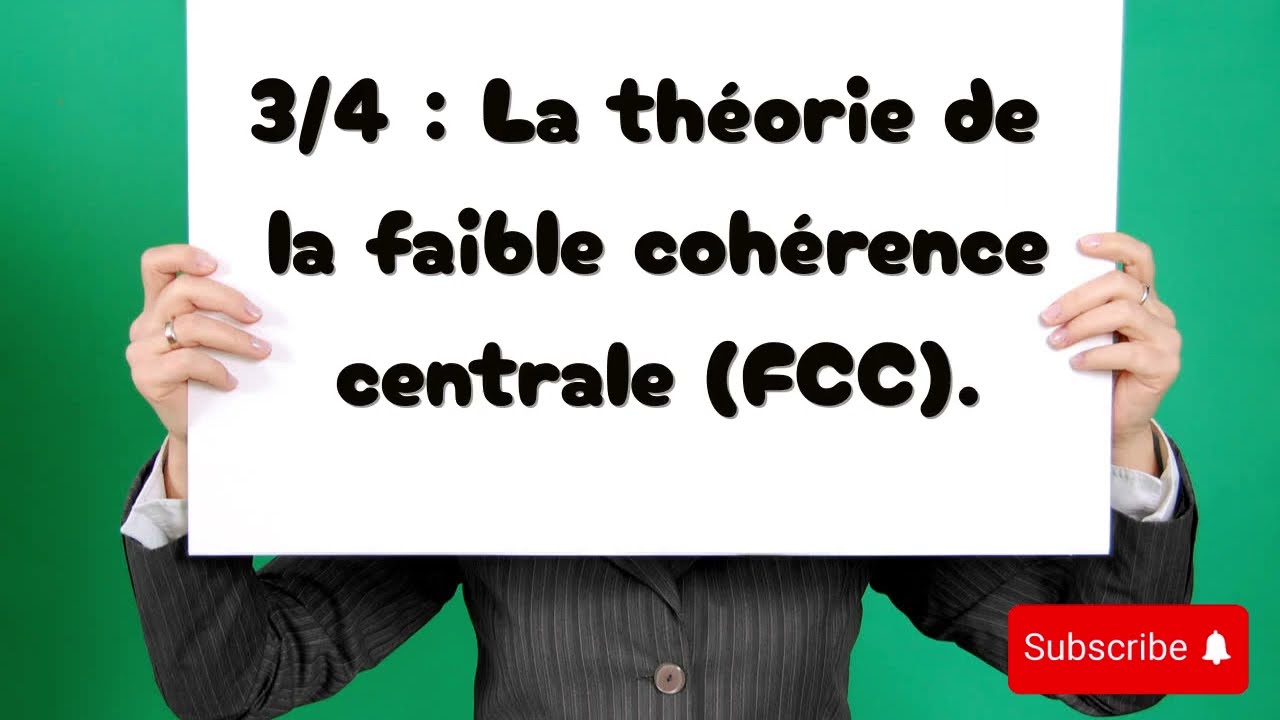Autisme / TSA, les différentes théories.

Ce sujet à l'ambition de présenter les différentes théories qui veulent expliquer ou définir l'autisme.
Le déficit de la Théorie de l'esprit ( ToM)
Imaginez que vous lisez un livre. Vous pouvez facilement comprendre ce que pense le personnage principal, quels sont ses désirs, ses peurs. Vous pouvez vous mettre à sa place.
Pour une personne avec autisme, ce processus peut être plus complexe. C'est un peu comme si elle avait du mal à "lire entre les lignes" des interactions sociales.
Qu'est-ce que la théorie de l'esprit ?C'est la capacité de comprendre que les autres personnes ont leurs propres pensées, sentiments, croyances et perspectives, qui peuvent être différentes des nôtres. C'est comme avoir une carte mentale des pensées des autres.
Pourquoi est-elle déficitaire dans l'autisme ?Les personnes avec autisme peuvent avoir des difficultés à :
- Reconnaître les émotions: Un sourire peut être interprété de différentes manières.
- Comprendre les intentions: Les gestes ou les paroles peuvent avoir des significations cachées.
- Prédire les comportements: Il est difficile d'anticiper ce que les autres vont faire.
Quelles sont les conséquences ?
- Difficultés dans les interactions sociales: Il peut être compliqué de se faire des amis, de comprendre les règles implicites d'une conversation.
- Malentendus fréquents: Les personnes avec autisme peuvent être perçues comme froides ou indifférentes, alors qu'elles ne comprennent simplement pas les codes sociaux.
- Anxiété sociale: La peur de ne pas comprendre les autres peut être source d'anxiété.
L'hypothèse du ToM a été posée par Simon Baron Cohen et par ses collègues en 1985.
Le déficit de la théorie de l'esprit ne signifie pas une absence d'empathie. Les personnes avec autisme ressentent des émotions, mais elles peuvent avoir du mal à les exprimer ou à les comprendre chez les autres.
Il est important de noter que chaque personne avec autisme est unique. Le degré de difficulté avec la théorie de l'esprit peut varier considérablement d'une personne à l'autre.
La théorie du dysfonctionnement exécutif :
Imaginez votre cerveau comme un chef d'orchestre. Il dirige tous les instruments (vos pensées, vos actions, votre mémoire) pour créer une symphonie harmonieuse. Chez les personnes sans autisme, ce chef d'orchestre est généralement très efficace.
Chez les personnes autistes, ce chef d'orchestre pourrait parfois avoir du mal à coordonner tous les instruments.
C'est ce qu'on appelle un dysfonctionnement exécutif.
Qu'est-ce que le fonctionnement exécutif ?
Le fonctionnement exécutif, c'est un ensemble de compétences qui nous permettent de :
- Planifier: Organiser nos tâches, établir des priorités.
- Inhiber: Réprimer une impulsion, se concentrer sur une tâche malgré les distractions.
- Flexibiliser: Adapter notre comportement à une nouvelle situation, changer de plan.
- Mémoriser: Retenir des informations, suivre des instructions.
Pourquoi serait-il parfois déficient chez les personnes autistes ?
Les raisons exactes ne sont pas encore entièrement comprises, mais on pense que cela pourrait être lié à :
- Des différences dans le cerveau: Certaines zones du cerveau impliquées dans le fonctionnement exécutif pourraient être structurées différemment.
- Une sensibilité accrue aux stimuli: Les personnes autistes peuvent être facilement surstimulées, ce qui peut rendre la concentration et la planification plus difficiles.
- Des difficultés dans la communication entre les différentes zones du cerveau.
Quelles sont les conséquences ?
Un dysfonctionnement exécutif peut se manifester de différentes manières, comme :
- Des difficultés à gérer le temps: Arrivées en retard, oublis de rendez-vous.
- Des problèmes d'organisation: Un bureau désordonné, des difficultés à suivre un emploi du temps.
- Des difficultés à changer de tâche: De la difficulté à passer d'une activité à une autre.
- Des difficultés à se concentrer: Se laisser distraire facilement.
Comment aider une personne avec un dysfonctionnement exécutif ?
Il existe de nombreuses stratégies pour aider les personnes avec un dysfonctionnement exécutif, comme :
- Mettre en place des routines: Avoir un emploi du temps visuel peut aider à organiser la journée.
- Diviser les tâches en petites étapes: Cela rend les tâches plus faciles à gérer.
- Utiliser des outils d'aide à la mémoire: Des agendas, des listes, des applications peuvent être utiles.
- Créer un environnement calme et structuré: Cela peut faciliter la concentration.
Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est donc essentiel d'adapter les stratégies en fonction des besoins spécifiques de chacun.
Le dysfonctionnement exécutif pourrait-être une caractéristique fréquente chez les personnes autistes, mais il ne définit pas toute la personne. Avec les bonnes stratégies et un soutien adapté, il est possible de vivre une vie épanouie malgré ces difficultés.
La théorie de la faible cohérence centrale :
Imaginez regarder une peinture. La plupart des gens voient d'abord une image d'ensemble, puis peuvent se concentrer sur des détails précis. Pour une personne avec autisme, il peut être plus difficile de voir cette image globale. C'est ce qu'on appelle la faible cohérence centrale.
Qu'est-ce que la cohérence centrale ?
C'est la capacité à intégrer des informations pour former une perception globale, un sens d'ensemble. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle pour voir l'image finale.
La théorie de la faible cohérence centrale et l'autisme
Cette théorie, proposée par Frith et Happé dans les années 1990, suggère que les personnes autistes auraient une tendance à se concentrer sur les détails plutôt que sur l'ensemble. Elles seraient donc moins capables d'intégrer les informations dans un contexte plus large.
Pourquoi cette théorie ?
- Les forces des personnes autistes: Souvent très douées pour les détails (maths, informatique), elles peuvent avoir des difficultés à comprendre les nuances sociales, les métaphores ou les expressions idiomatiques.
- Les difficultés sociales: La compréhension des interactions sociales nécessite de saisir les intentions, les émotions, le contexte, ce qui demande une bonne capacité de cohérence centrale.
Les conséquences
- Difficultés dans la communication: Les personnes autistes peuvent avoir du mal à comprendre les sous-entendus, les sarcasmes ou les non-dits.
- Intérêts spécifiques: Elles peuvent se concentrer sur des sujets très précis, en négligeant d'autres aspects de la vie.
- Sensibilité aux stimuli: Les détails peuvent être tellement présents qu'ils peuvent devenir une source de distraction ou d'anxiété.
La théorie de la faible cohérence centrale propose une explication intéressante pour certaines caractéristiques de l'autisme. Elle souligne l'importance de considérer les forces et les difficultés des personnes autistes, liées à leur façon de percevoir et de traiter l'information.
Malgré son influence, le modèle de Frith a été critiqué pour son approche réductionniste, qui sous-estime les contextes dans lesquels la focalisation sur les détails est un atout.
La théorie du monotropisme :
Imaginez votre attention comme un projecteur. Pour la plupart des gens, ce projecteur balaie une large zone, illuminant différents aspects de leur environnement. Pour une personne autiste, ce projecteur est souvent plus concentré, comme un laser, focalisé sur un intérêt particulier. C'est l'essence de la théorie du monotropisme.
Qu'est-ce que le monotropisme ?
Le monotropisme est une théorie de l'autisme développée dans les années 1990 par des chercheurs en psychologie, dont une est elle-même autiste Wenn Lawson et Dinah Murray qui ne l'est pas. Cette théorie propose que les personnes autistes aient tendance à concentrer leur attention sur un nombre limité d'intérêts à la fois.
Pourquoi cette théorie ?
Les personnes autistes qui ont développé cette théorie ont observé que leur manière de penser et de percevoir le monde était différente. Elles ont remarqué qu'elles avaient souvent des intérêts très spécifiques et intenses, et que ces intérêts pouvaient parfois monopoliser leur attention.
Les conséquences du monotropisme
- Intérêts spécifiques et intenses: Les personnes autistes ont souvent des passions très fortes pour certains sujets, qu'ils explorent en profondeur.
- Difficultés à se concentrer sur plusieurs choses à la fois: Le fait de concentrer son attention sur un seul intérêt peut rendre difficile de suivre une conversation ou de participer à des activités qui requièrent de jongler avec plusieurs informations.
- Sensibilité aux stimuli: Les personnes autistes peuvent être facilement surstimulées par un environnement trop riche en stimuli, ce qui peut rendre difficile de se concentrer sur l'intérêt principal.
En quoi le monotropisme diffère des autres théories ?
Contrairement à d'autres théories qui considèrent l'autisme comme un déficit, le monotropisme le présente comme une différence neurologique. C'est une façon de penser et de percevoir le monde qui est simplement différente de la norme.
Les avantages de cette théorie
- Elle est développée par des personnes autistes: Wendy Lawson est elle-même autiste, cela lui confère une légitimité particulière, car elle est basée sur les expériences vécues.
- Elle met l'accent sur les forces: Le Monotropisme souligne les intérêts spécifiques et les compétences souvent remarquables des personnes autistes.
- Elle permet une meilleure compréhension de l'autisme: En comprenant le fonctionnement du cerveau monotrope, il est possible de développer des stratégies pour mieux accompagner les personnes autistes.
Le monotropisme offre une perspective différente sur l'autisme, en mettant l'accent sur les forces et les différences des personnes autistes. Cette théorie, développée par des autistes pour les autistes, contribue à une meilleure compréhension de cette condition neurologique.
L'étude de Dwyers et al (2024) présente des éléments entérinants des éléments de cette hypothèse.
Pour aller plus loin sur ces lectures, je vous renvoie vers l'article de la psychologue spécialisée Nathalie Boisselier. Vous y trouverez les références des études.
https://www.psynice.net/post/autisme-et-tda-h-la-th%C3%A9orie-int%C3%A9grative-du-monotropisme